
- Pilleurs d’epaves
Le droit de bris (ou droit de lagan, ou perçois de mer, ou le peñse) appartient aux Ducs de Bretagne au Moyen Age comme droit régalien, mais leurs vassaux du littoral en usaient par concession ou par usurpation. Il en fut ainsi du Vicomte de Léon : en vertu du droit seigneurial, toutes cargaisons de marchandises jetées sur le littoral lesnevien (des grèves de Tréflez à celles de Plouguerneau) devenaient propriétés exclusives du châtelain de Lesneven. Ce droit était particulièrement cher au seigneur du lieu, si l’on s’en rapporte aux déclarations d’un certain Hervé, vicomte du Léon qui, du doigt, désignant un groupe de rochers du littoral - Kerlouan, vraisemblablement - s’écria : « Voilà une pierre noire que je n’échangerais pas pour les diamants de toutes les couronnes du monde ».
Au milieu du XVè siècle, le châtelain renonça momentanément au droit d’épaves au profit d’un gentilhomme qui, en compensation, devait fournir les cordages nécessaires à la pendaison des criminels déférés à la cour de Lesneven. En 1457, ces fonctions étaient dévolues à l’un des trois choristes du Folgoët, « un petit Pilguen de Plouider, du doux manoir de Kérouriou. Il avait la maîtrise sur toutes les grèves du littoral lesnevien, ce qui lui faisait dire : flux ou reflux, je suis partout le maître et Kérouriou est mon nom ».
. Ce rocher, cause continuelle de naufrages, était situé, selon certains auteurs, sur le littoral de Kerlouan (Marius-Fernand et Louis BLANC, « Histoire anecdotique de Lesneven, du Folgoët et des alentours », Brest, 1927). Mais Cambry le fixe à la pointe du Raz, territoire relevant également à l’époque du Comté de Léon.
L’Eglise tenta de lutter contre ce droit de bris : ainsi, lors d’un synode tenu à Nantes en octobre 1127, elle condamna cet usage et menaça d’excommunication ceux qui n’y renonceraient pas. Mais l’habitude était tellement ancrée dans les mœurs que les interdictions maintes fois renouvelées n’y changèrent rien. Les conflits continuèrent entre les ducs et les vicomtes de Léon pour la possession de ce droit et se poursuivirent encore avec le pouvoir royal après le rattachement de la Bretagne à la France.
L’édit de 1691 organisa les amirautés : celle de Léon avait son siège à Brest. Le personnel n’était pas nombreux et souvent éloigné des lieux de naufrages ; les juges déléguèrent leurs pouvoirs à des représentants pour assurer une meilleure surveillance des côtes : des commis et des garde-côtes. C’était le cas à Guissény où l’on peut toujours voir la maison des gardes (« le corps de garde ») . Toutes les autorités locales (curés, seigneurs, syndics) avaient obligation de prévenir l’amirauté, de s’occuper du sauvetage et d’empêcher les pillages avant l’arrivée des officiers. Pendant la révolution, cette mission fut confiée aux juges de paix des cantons et aux douaniers.

- Le Corps de Garde
Les habitants de ces littoraux qui menaient une vie difficile et avaient l’habitude de se battre avec les éléments marins pour récolter le goémon, voyaient arriver les débris des naufrages comme une bénédiction. « Cette culture littorale se fonde sur un raisonnement simple : tout ce que la mer apporte aux découvreurs s’apparente à une cueillette naturelle pour des individus qui ne possèdent pas grand chose [Jean Pierre Hirrien] ». Lorsqu’un naufrage était connu, la population arrivait de toutes les paroisses voisines : lors du naufrage du Bon Succès (le 25 décembre 1787), on observe la présence de représentants de six paroisses (Kerlouan, Guissény, Plouguerneau, Lannilis, Ploudaniel et Lesneven) et « des charrettes aussitôt attelées ont transporté dans plus de trente paroisses le fruit de leurs rapines ».
Entre 1681 et 1815, J.-P. Hirrien compte 6 naufrages à Guissény et 18 à Kerlouan, dont 6 ont donné lieu à des pillages. Toutes les communautés littorales participaient plus ou moins au pillage mais tous leurs membres ne se comportaient pas de la même façon : Cambry notait « qu’il existe pourtant des familles qui ne participent jamais à ces vols ; qui se croiraient déshonorées si, quand la multitude court au rivage et va se partager la dépouille des naufragés, elles faisaient un pas pour y participer ». L’intérêt des pilleurs se concentrait sur trois marchandises principales : le bois, les vêtements et l’alcool. Les violences envers les équipages sont en général limitées : les pillards portent secours aux rescapés, du moins lorsque ceux-ci ne cherchent pas à s’opposer au pillage.
Les frères Blanc, dans leur livre sur l’histoire de la région, rapportent un certain nombre d’anecdotes relatives au pillage des épaves du côté de Guissény et de Kerlouan. Ils relatent, par exemple, le fait qu’à leur époque (début du XXè siècle), il est rare de trouver le moindre bijou sur les cadavres déclarés par les Paganis : « Or, les marins ont toujours des montres sur eux, dit un brigadier des douanes, et j’ai souvent relevé au doigt des cadavres déclarés le rond pâle que laisse une bague et les écorchures encore fraîches qui prouvent que l’anneau avait été arraché violemment ».
Les épaves que la tempête et les courants entraînent vers le littoral, et plus spécialement les « spiritueux en fûts », auxquels ces populations semblent accorder une préférence marquée, sont toujours considérés comme « un don du ciel ». Ainsi, en 1903, lors du naufrage du Wesper, dans les parages d’Ouessant, quantité de fûts et de barils de vin, emportés par le courant, vinrent, pour la plus grande joie des riverains, s’échouer parmi les nombreux rochers des grèves de Kerlouan. Avec une adresse et une dextérité surprenantes, les Paganis recueillirent quantité de fûts, prestement dissimulés à l’œil inquisitorial « des gabelous » (douaniers).

- Pilleurs d’epaves (Auguste Lepère)
Alors, durant de longs mois, ce fut une beuverie interminable : hommes, femmes et enfants purent, sans bourse déliée, se livrer à de copieuses libations. Or, il advint que, dans une ferme isolée du littoral, la maisonnée tout entière demeura plusieurs jours sous l’empire de l’ivresse, sans souci aucun des quelques têtes de bétail enfermées dans l’étable. Même, les lugubres beuglements de ces pauvres bêtes ne purent faire sortir de leur torpeur les gens de la ferme. La presque totalité de ce bétail succomba d’inanition.
Un autre fait, ayant trait au même naufrage, témoigne de l’astuce, du cynisme de certains pilleurs d’épaves : une honorable et vieille commerçante de Guissény, ignorant tout d’ailleurs des lois réglementant la vente des épaves, se laissa fléchir par les instances aussi obsédantes qu’intéressées d’un de ces endurcis pirates de Garrec-Hir, en Kerlouan, et lui acheta un superbe fût de vin d’épave. La livraison, contre remboursement, s’effectua par une nuit profonde et obscure. L’astucieux livreur poussa la complaisance jusqu’à dissimuler entièrement le tonneau sous des fagots entassés dans la cour de l’habitation, avec recommandation expresse de ne point mettre la futaille en perce avant une vingtaine de jours, afin que le dépôt du liquide pût s’opérer dans de bonnes conditions. Cette recommandation n’était ni superflue ni surtout désintéressée : le délai expiré, notre brave et trop confiante aubergiste s’apprêtait enfin à procéder à la mise en bouteilles du précieux liquide lorsqu’elle s’aperçut de la disparition mystérieuse du fût ! Elle apprit dans la suite que le cynique pirate, non content d’avoir empoché l’argent, avait mis à profit une nuit noire pour procéder à l’enlèvement du vin avant la date qu’il avait lui-même si obligeamment fixée pour la mise en bouteilles. Que faire en l’occurrence ? Déposer une plainte ? Il n’y fallait point songer, sous peine d’encourir les foudres du fisc. Mieux renseignée, notre infortunée aubergiste jura - mais un peu tard - qu’on ne l’y reprendrait plus !
A propos de ce même naufrage, un entrepreneur de la région lesnevienne, en relations constantes avec les Paganis, raconta aux frères Blanc les faits suivants, vraiment typiques, dénotant de la part de leurs auteurs une mentalité peu ordinaire :
Dès qu’on apercevait un fût flottant sur les eaux, on allait à sa rencontre à la nage. On le déposait verticalement sur le sable ; on en faisait sauter la partie supérieure ; puis, au moyen de sabots d’une propreté plus que douteuse, chacun s’abreuvait à qui mieux mieux. Le niveau du liquide s’abaissait-il ? L’un des sauveteurs, en tenue de bain, sautait dans le tonneau et remplissait tous les récipients qu’on lui présentait.
Plus loin, deux paysans roulaient discrètement deux énormes fûts de vin. On les aperçoit. Ils se voient aussitôt entourés d’une meute hurlante, réclamant une part du précieux butin. Le vacarme est tel que les douaniers, accourus, ordonnent jusqu’à plus ample informé, la remise des fûts dans une grange voisine, au seuil de laquelle ils montent la garde jusqu’à la nuit tombante. Sitôt partis, la grange est assaillie, la porte démolie, les fûts défoncés, puis une bataille générale s’engage à coups de seaux pour la possession du vin.

- Pilleurs d’epaves
Dans les mêmes parages, un vieux paysan des plus madrés avait réussi à recueillir 12 tonneaux de vin. Heureux de son aubaine, il remisa le tout dans sa grange. Pour plus de sûreté, il fit murer l’ouverture de la remise. Précaution illusoire pour qui connaît les ruses des pilleurs d’épaves. Peu de jours après, en effet, trois tonneaux sont enlevés : la toiture en chaume avait été défoncée et les trois épaves, à l’aide de forts cordages, avaient disparu par cet orifice d’un nouveau genre. Outré d’un pareil sans-gêne, notre rusé paysan s’arma d’un fusil et la nuit demeura en faction au seuil de sa remise. Mais ses compatriotes sont gens à ne point se laisser intimider. A leur tour, ils s’armèrent de fusils de chasse et la poudre entra en jeu. Ce fut miracle si personne ne perdit la vie. Tous ces coups de feu avaient attiré l’attention des douaniers qui mirent fin à ces combats en pratiquant l’enlèvement des fûts restants, objets du litige, et en gratifiant nos bons bougres de quelques procès-verbaux pour détention et enlèvement illicites d’épaves. N’est-ce pas au cours d’une de ces orgies « qu’une vieille femme fut retirée d’un fût où elle se penchait trop amoureusement » et qu’une autre hallucinée s’écriait : « O Dieu puissant qui changes la mer en vin » ?
Lors du naufrage de l’Amboto, chargé de houille, et survenu le 14 juillet 1908, plusieurs habitants de Garrec-Hir - principal quartier, avec Kérisoc, des pilleurs d’épaves - montèrent à bord du navire pour enlever tout objets à leur convenance : glaces, cuivre, etc… Les chaînes mêmes ne furent pas épargnées ; on les enleva à coups de masse et tout cela en présence de l’équipage, littéralement ahuri par un tel cynisme. Si certains pilleurs d’épaves impénitents font des dupes, des victimes, d’autres par contre, paient, parfois de leur vie, leur amour immodéré de certaines épaves, témoin le fait suivant : « Le 19 août 1917, de nombreux cultivateurs coopéraient aux travaux agricoles, à la ferme Habasque en Kerlouan. Après le battage de la récolte, il fut offert aux travailleurs quelques petits verres d’alcool. Or, dès le lendemain, l’un des buveurs, Jean Coat, domicilié à Ploudaniel, était fortement indisposé, se plaignait surtout de douleurs à la tête. Un docteur fut mandé qui ordonna le transfert du malade à son domicile. Mais ce dernier ne put supporter le voyage et mourut en cours de route. Le même jour, Tanguy Le Bihan, qui avait également travaillé la veille chez son voisin Habasque, mourait dans les mêmes conditions à son domicile. Deux autres cultivateurs, Jean Jaffrès et Ollivier Bihan furent fortement indisposés. La justice fut mise au courant de ces faits, et l’on apprit que Habasque avait découvert peu de temps auparavant, sur la grève, un fût d’alcool, qu’il crut être du trois-six. Sa fille avait alors mélangé ce liquide, qui n’était autre que de l’esprit-de-bois, avec de l’eau-de-vie ordinaire. C’est ce breuvage qui avait été donné aux travailleurs et qui occasionna leur mort. François Habasque et Marie Jeanne Habasque furent condamnés à deux mois de prison avec sursis » [Extrait du journal « La Dépêche de Brest et de l’Ouest », 9 février 1918].
Au cours de l’année 1918, plusieurs navires sont encore torpillés dans les parages de Kerlouan. L’un était chargé de grandes feuilles de caoutchouc vulcanisé, sorties d’une grande firme américaine. Les riverains de Garrec-Hir, notamment, en font une ample récolte dont ils escomptent déjà le produit de la vente. Mais les douaniers sont là, l’œil aux aguets et l’oreille aux écoutes. Impossibilité absolue d’écouler immédiatement les précieuses épaves. Alors nos bons pirates, en vue de remédier sans doute à la pénurie du bois dans la région, imaginent d’utiliser les feuilles de caoutchouc comme combustible ! Les vapeurs âcres et sulfureuses qui s’en dégagent leur chatouillent fort désagréablement les narines et les obligent à renoncer, dès le premier essai, à ce genre de combustion peu ordinaire. Des personnes peu scrupuleuses, mais plus avisées, en quête d’une bonne aubaine, parviennent après paiement et après avoir trompé la vigilance des douaniers, à se procurer plusieurs feuilles de ces épaves, vite découpées en pièces et sitôt débitées pour servir de semelles aux chaussons et aux espadrilles ! Ce nouveau genre de semelles remporta, à Guissény, un succès incroyable, surtout près des femmes et des enfants. Tous en portaient au vu et au su des douaniers. « Que voulez-vous, disait M. H…, l’actif brigadier des douanes, nous ne pouvons cependant pas verbaliser contre toute la population ? Nous avons déjà fait rendre gorge à quelques-uns des pilleurs d’épaves disposés à en faire livraison à des industriels - mercantis, peut-être, - de Brest, de Landivisiau et… d’ailleurs. Un moment, nous avons cru mettre la main sur l’un de ces gros receleurs : son auto stationnait à la porte d’une ferme tenue par nous à l’œil. Éventé, le coup a manqué. Espérons que ce n’est que partie remise ; bientôt, peut-être, aurons-nous notre revanche… ». Par la suite, l’active brigade de Guissény réussit à récupérer plus de 7.000 kilos de feuilles de caoutchouc !.
La tradition du pillage était profondément ancrée dans la mentalité des populations du pays pagan comme en témoignent ces dictons et cette profession de foi prêtée aux gens de Guissény, selon Michel de Mauny :
Lec’h ma dremen ar Pagan | Partout où passe le Pagan Atao e daol e graban | Toujours il lance sa main crochue
Paotret Guisseni | Gars de Guissény Paotret ar c’hill krok | Joueurs de perche à crochet (pour tirer au sec les épaves)
La profession de foi dit ceci :
Avel uhel, avel Nord | Le vent haut, le vent du Nord A zigas ar pense d’ar bord | Amène les épaves à la côte Ha me araok | Et moi d’y courir Da c’hoari va Paotr | Pour y faire mon beau diable Ha pad-agenn d’ar grouk | Et que j’irais à la potence Tenio eun tortad war | J’emporterai mon faix (de butin) Va chouk | Sur mes épaules
L’ancienne auberge du bourg de Guissény était le témoignage vivant de cette tradition de pilleurs d’épaves (Charles Le Goffic, "Sur la côte") :
« Une des auberges les plus curieuses que j’aie visitées, est à Guissény. C’est la principale de l’endroit et elle fait hôtel pour les voyageurs de commerce et les rares baigneurs qui s’y rendent aux beaux mois. Le patron de l’auberge est en même temps ébéniste et marchand de curiosités. L’auberge est propre et sans grande apparence extérieure. Mais, à peine entré, on est frappé par la singularité de l’ameublement : la table de la salle à manger est une table longue, en acajou massif, comme les tables des paquebots ; la suspension, les serrures, les poignées des portes, les patères sont en cuivre, comme à bord. Pour descendre dans la cour, vous suivez une rampe de passerelle ; dans cette cour même, vous apercevrez d’énormes ancres, des organeaux, des ventilateurs, des mâts de charge. Trois ou quatre de ces mâts, encore cerclés de fer, supportent la toiture d’un hangar ; dans ce hangar, pêle-mêle, avec de vieux bahuts, des crédences et des lits bretons, voici des planches de pitchpin, des billes d’acajou verdies par la mer. D’où vient tout cela ? du Penzé. Chacun de ces objets a sa date, se rapporte à un naufrage lointain ou récent. Et vous ne voyez encore que ce qui peut être montré ou que couvre la prescription. Le cas de ce patron d’auberge est-il unique ? Point. On me cite un tel, ancien meunier retiré des affaires, ayant grande habitation bourgeoise, cour, arrière-cour, jardin fruitier, potager et d’agrément, et dont tout le mobilier, jusqu’aux ustensiles de ménage, trahit la même origine. Evidemment ni cet ancien meunier ni cet aubergiste ne sont des pilleurs d’épaves… ».
La mer continue à apporter des matières diverses sur les plages du pays pagan. Lorsqu’il y a un arrivage intéressant le vieil atavisme se réveille très vite, le bouche-à-oreille fonctionne très bien (surtout maintenant avec les smartphone et les réseaux).La plage est très vite nettoyée des planches de bois, des paquets de tabac,… Mais lorsque la mer apportait ses nappes de pétrole, les Paganiz savaient aussi serrer les coudes pour se débarrasser au plus vite de cette pollution.
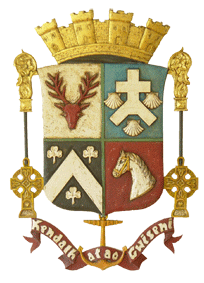
 Les Paganiz, des pilleurs d’épaves
Les Paganiz, des pilleurs d’épaves