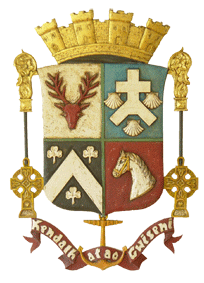A propos du nom « Pagan »
Les limites de ce Bro Pagan ou Lan Pagan ne sont pas faciles à déterminer et changent selon les auteurs. D’après Michel de Mauny, « pour les Lesnevinois, le pays Pagan se réduit aux quatre communes bordant la mer : Guissény, Kerlouan, Plounéour-Trez (y compris Brignogan qui n’en fut détaché et érigé en paroisse que le 7 juin 1935) et Goulven ». Pour Pol de Courcy, le pays est un peu plus étendu, depuis Tréflez à l’est jusqu’à Plouguerneau et l’embouchure de l’Aber Wrac’h à l’ouest. Si la mer constitue naturellement la limite nord, en revanche la limite sud est également très floue, ne dépassant pas la frange littorale : pour les Guisséniens, « ceux de l’Arvor, de la côte, sont seuls des Paganiz, ceux du bourg et de l’intérieur étant des Léonniz ». "Le nom pagan vient du latin « paganus », habitant d’un « pagus », circonscription rurale de la Gaule d’où est venu pays et paysan. Paganiz doit donc se traduire par paysan…"(Michel de Mauny).
La plus ancienne mention du nom Pagan que j’ai trouvée dans le registre des baptêmes de Guissény date de 1659 : l’acte de Jeanne COLLOSQUET fille légitime et naturelle de Lorans dit pagan et de Catherine Prigent, née le 7 mai 1659 et baptisée le 8 par le recteur de Guissény, parrain Charles Henry et marraine Jeanne Henry (du manoir de Kergoff).

- Pagan°1659
Jeanne Collosquet a un frère François, né le 22 avril 1669, dont le père Lorans est aussi « dit Pagan ». Il y avait également une sœur Marie Collosquet, dit Pagan, fille de Catherine Prigent, décédée le 22 avril 1695 à l’âge de 30 ans (donc née en 1665).
Il existe aussi un autre couple Jacques COLLOSQUET et Marie SALOU qui a 3 enfants pour lesquels le père est « dit Pagan » : François, né le 22 octobre 1666 ; Jean, né le 11 décembre 1669 ; Allain, né le 27 février 1675. Une autre enfant Marie, née le 28 septembre 1677, ne comporte pas le surnom.
Ensuite on trouve le nom « pagan » directement comme nom de famille pour le baptême de Catherine Pagan, le 23 septembre 1664, fille légitime et naturelle de Jean Pagan et Janne Lesteven.

- Catherine Pagan°1664
On trouve aussi dans le rôle des fouages de Guissezny pour l’année 1670 un Laurans PAGAN au village de Trerochan qui doit payer 13 sols et un Jacques PAGAN du bourg de Guissezny qui doit payer 2 sols. Ils n’apparaissent plus dans le rôle des fouages de 1681 [Le fouage est un impôt provincial prélevé par le duc de Bretagne sur les foyers roturiers]. S’agit-il de Lorans et Jacques Collosquet, dit Pagan, cités plus haut ?
A Kerlouan, la plus ancienne mention connue (semble-t-il) du mot « pagan » dans un registre figure dans un acte de baptême, daté du 24 juin 1672 : « Jan, fils légitime et naturel d’Alain Uguen pagan et Marie Uguen sa femme, fut né et baptisé le vingt et quatrième jour de juin mil six cents septante deux par le soussignant Curé, ayant à parain et maraine Christophe Roparz et Marguerite Habasque ; J. Gall, Curé ».

- UguenJan, fils de Alain Uguen Pagan°1672
L’acte de décès d’Alain Uguen, du 12 décembre 1692, apporte une précision : « Alain Uguen dit pagan mourut le douziesme jour de décembre mil six cents quatre vingts douze et fut enterré le treiziesme du dit mois au dit an dans la chapelle de Saint Egarec en présence de Guillaume Uguen son fils, Alain Guen son gendre… ».

- UguenAlainPagan+1692
Le mot « pagan » est donc utilisé dans ce cas comme le surnom d’Alain Uguen. Les actes des registres paroissiaux de Kerlouan mentionnent très souvent ainsi le surnom des intéressés, comme Henry dit Toupin, Habasque dit Toby,… Mais nous ne savons rien de la signification de ce mot en tant que surnom à cette époque (XVIIe siècle).
Tanguy MALMANCHE, auteur de la pièce « Les Païens » (en breton « Ar Baganiz »), explique le choix de son titre dans les notes de son ouvrage.

- Les païens (éditions Aber)
"L’origine des Paganiz est restée assez nébuleuse. Parce qu’ils tranchaient nettement sur les populations avoisinantes, dont ils se tenaient isolés et auxquelles ils considéraient même comme un déshonneur de s’allier par mariage, on a voulu les voir d’une race différente et on s’est livré, dans ce sens, aux suppositions les plus téméraires. N’est-on pas allé jusqu’à les prétendre descendants de pirates scandinaves, sous prétexte que leurs costumes -modernes, notez-le bien - avaient une très vague ressemblance ave ceux des paysans norvégiens ! Ainsi ces fils de Rollon, ayant perdu jusqu’au souvenir de leur mère-patrie, auraient continué, par on se demande quel mystérieux phénomène, à être tenus au courant de ses modes !
Une opinion plus généralement admise, parce que à première vue tout au moins - plus raisonnablement admissible, est que les Païens ont été nommés ainsi parce que… eh bien, parce qu’ils étaient païens ! Soit. Mais établit-on qu’ils l’étaient réellement ? Pas du tout. On se borne à raisonner comme suit : Paganiz s’apparente évidemment à paganisme, et ceux qui s’adonnent au paganisme sont des païens !

- Mon arrière-grand-père Jean Bocher
Or, je dois le dire tout net - à la suite d’ailleurs d’autorités comme un Dotin et un La Passardière -, nous nous trouvons ici en présence d’une des plus belles manifestations de cet esprit calembourique qui, mis à la mode par les hagiographes et continué par les celtomanes genre Le Brigant, a si longtemps tenu lieu de science à la plupart de nos étymologistes bretons. Le vrai, c’est que Pagan vient du latin paganus, qui est l’habitant d’un pagus, circonscription rurale de la Gaule qui a donné pays. La traduction correcte de Paganiz serait donc non pas Païens mais Paysans. Si, dans la version française de ma pièce, j’ai adopté le terme vicieux, c’est qu’il est consacré par l’usage, et par suite le seul qui pour un Breton représente quelque chose.
On objectera que païen dérive aussi de paganus et que, même si ce n’est que dans des cas très particuliers que ce mot a eu le sens de paysan idolâtre, ce fut peut-être justement celui des Paganiz. Or, cela, rien ne l’établit ; tout prouve même le contraire. Les Païens actuels sont les propres descendants des Bretons immigrés en Armorique aux premiers siècles de l’ère chrétienne sous la conduite de leurs « saints » Sezny, Goulven, Fracan et autres, dont ils ont, du reste, gardé le culte ininterrompu.
Et s’ils furent l’objet au début du XVIIe siècle d’une « évangélisation » par le grand prédicateur Michel Le Nobletz, ce fut au même titre que tout le reste de l’évêché de Léon qui n’était certes pas idolâtre, tout en étant - il faut bien le croire - encore moins chrétien qu’eux, puisque le pauvre missionnaire, qui était du Conquet, avouait humblement que la paroisse qui lui donnait le plus de fil à retordre, c’était la sienne propre !

- Dom Michel Le Nobletz
L’isolement farouche dans lequel les Païens ont été tenus si longtemps est dû, tant à l’attachement chez eux de l’esprit de clan, de fief et de paroisse, qu’à la déconsidération que leur valait leur renom de pillards invétérés. J’ai encore connu le temps où, dans les foires de Lesneven, des marchands ramassaient précipitamment leurs étalages, quand ils voyaient apparaître, reconnaissable à son habit bleu clair et à son bonnet à revers, un « paotr krogek e viziad », un gars aux doigts en croc…
Maintenant, il arrive fort bien qu’une « héritière » de Kerlouan épouse un « étranger » de Plabennec ou d’ailleurs. Mais quand, dans son nouvel entourage, on parle d’elle, on ne l’appelle jamais de son nom de fille, comme c’est l’usage. On l’appelle toujours ar Baganez, la Païenne".
Le Léon à l’époque romaine (Patrick Galliou, Rencontres historiques du Musée du Léon, 1990) : Bien que nous ne sachions pas grand-chose de l’organisation politique des peuples d’Armorique à la fin de l’Age du Fer, il est fort probable que le Léon était occupé, dès avant la conquête romaine, par une ou plusieurs des unités territoriales quasi-autonomes du vaste peuple des Osismes…
Cette partition ne fut pas supprimée par l’autorité romaine conquérante et le développement de la petite ville gallo-romaine de Vorganium (Kérilien en Plounéventer), au cœur de ce terroir, s’accorde bien avec ce que nous savons de l’organisation des pagi en Gaule romaine. Ces cellules de base y sont en effet d’ordinaire pourvues d’un chef-lieu, jouant, à son échelle, un rôle semblable à celui de la capitale de la civitas.

- Kerilien
Nous ignorons toutefois si ce que nous appelons aujourd’hui le Léon était, à cette époque, occupé par un ou plusieurs pagi, car la Vie de saint Paul Aurélien, rédigée par le moine Uurmonoc en 884, nous donne à connaître deux unités distinctes, le pagus Leonensis et le pagus Agnensis, le nom de ce dernier étant d’origine celtique (pays d’Ach, dérivé d’Axmensis, lui-même dérivé du gaulois Aximos = le très maritime)".
Au XIXe siècle, la bourgeoisie brestoise considère avec condescendance la campagne environnante dont elle méconnait la vie profonde et en général ignore la langue : "C’est ainsi que, parmi les paysans bas-bretons, ignares et grossiers, livrés à la « superstition », elle tient en particulier méfiance et parfois en abomination, les naturels du Pays Pagan (le Lan ar Pagan, qui s’étend entre la baie du Vougot, à l’Ouest, et celle de Goulven, à l’Est, comprend les paroisses de Guissény, Kerlouan, Brignogan et Plounéour-Trez)".
En 1818, la revue La Guêpe (feuille libérale et anticléricale de Brest, animée par Edouard Corbière, décrit les Pagans comme "des espaces de sauvages à moitié nus…. La plupart de nos paysans sont encore plus grossiers que les peuplades que nous avons voulu policer dans le Nouveau Monde. Il y a peu de temps que les Lumières se répandent en Russie, et il n’est pas sur les bords du Boristhène et du Don, un Russe qui soit moins ignorant et moins féroce que les hommes dont nous parlons. Il est inconcevable, et nous osons le dire, il est honteux que la France, au dix-neuvième siècle, ait encore des sauvages".
Ces « sauvages » accèdent à la « civilisation » dans les années suivantes si l’on en croit ce qu’écrit le Général Le Flo, de passage à Guissény où il avait des liens familiaux, le 22 avril 1858 :
"Guissény, commune sur la côte, à 3 lieues de Lesneven et une lieue de Kerlouan. Ce canton renferme une des plus vigoureuses populations de la Bretagne. Pays riche en outre. Nous sommes allés, mon frère et moi, visiter une ferme de notre mère, la ferme de Kerandraon, Gac fermier, sur le bord de la mer. Rencontré un jeune paysan, fils du fermier, grand gaillard bien découplé, parlant bien le français et quelques peu phraseur.

- Adolphe LE FLO
Ces braves gens s’émancipent, évidemment, et ne ressemblent plus que fort peu à ces demi-sauvages d’il y a seulement 25 ans. Cela porte son enseignement. Est-ce un bien, est-ce un mal ? Selon beaucoup de bons et grands esprits, c’est le symptôme de la Révolution qui marche… C’est possible ! Selon moi, c’est un progrès de l’humanité, un pas de plus vers la Liberté et la véritable Egalité dont le triomphe assurera seule le calme, la tranquillité du monde et la sécurité des intérêts…"
[Adolphe le Flo était par sa mère un descendant de la famille Henry de Kergoff de Guissény]
Avant de visiter le Lann ar Paganis, nous nous imaginions un peu que la population était restée à peu près à l’état sauvage. Quelqu’un connaissant le pays, y étant allé assez souvent, nous disait : "Vous serez étrangement surpris de l’urbanité de ces paysans, qui parlent un français très correct, et ne passent jamais auprès d’un étranger sans lui adresser quelques paroles aimables. Si vous demandez un renseignement, il vous est donné volontiers avec force détails". Et en effet, en parcourant à pied les paroisses de Guissény, Kerlouan, Plounéour-Trez, nous n’avons trouvé partout que visages ouverts et paroles obligeantes.
Pour Louis Elégoët (Le Pays Pagan, Palantines, 2012) :
"Les limites du Pays pagan, si l’on remonte dans le temps de quelques décennies seulement, étaient à géométrie variable. Si l’on s’informait sur cette question en Paganie, le Pagan, c’était l’homme de la commune d’à côté. Pour l’habitant de Guissény, c’était le Kerlouanais ; pour celui de Kerlouan, c’était l’indigène de Plounéour-Trez. Il en va tout autrement de nos jours : de plutôt négative qu’elle était naguère, l’identité pagane est devenue positive.
Aujourd’hui six communes trouvent à se loger dans le territoire pagan : Goulven, Plounéour-Trez, Brignogan (créé, en 1934) à la suite du démembrement de Plounéour-Trez), Kerlouan, Guissény et Plouguerneau [aujourd’hui avec la refonte de Brignogan avec Plounéour-Trez, il n’y a plus que 5 communes concernées].
Outre leurs caractères communs qui est, entre autres, de vivre de la terre et de la mer, ces communes forment une presqu’île délimitée par deux cours d’eau : la Flèche à l’est, l’Aber-Wrac’h à l’ouest. La position péninsulaire du Pays pagan y a déterminé un isolat humain qui n’a pas son équivalent dans le Léon. Elle explique en grande partie son originalité".
La délimitation du pays pagan est donc toujours d’actualité aujourd’hui mais plutôt pour des raisons touristiques, car il est désormais important, pour les communes, de se rattacher à un « pays ». En ce début du XXIè siècle, le pagus gaulois est ainsi remis à l’honneur.
Notre commune de Guissény forme avec ses voisines la « Côte des Légendes », associées dans une communauté de communes au Pays de Lesneven, plus large que le pays pagan. La principale de ces « Légendes » est sûrement celle des naufrageurs et des pilleurs d’épaves.
Sources :
- Michel de Mauny, « Le pays de Léon - Bro-Léon ».
- Guissény : Yvon Gac
- Kerlouan : Les Cahiers de l’Iroise : Ar Furcher, « Sur l’origine du mot Pagan », n° 3, 1973, p. 175, et Claude et Danièle LE MENN, « Sur l’origine du mot Pagan et les surnoms kerlouanais », n° 4, 1985, p. 195-196.
- Yves Le Gallo, "Brest et sa bourgeoisie sous la Monarchie de Juillet", PUF, 1968.
- Général Le Flo, "Notes sur mon pays - de Brest à Morlaix- (1849-1886).
- Louis LE GUENNEC, "Le Finistère monumental - tome II : Brest et sa région".
- Archives départementales de Quimper et CGF29
Le naufrage de l’Eulalie en 1814
Le registre de délibération du conseil municipal de Guissény dresse le constat d’un naufrage dans la baie de Trésséni le 1er mars 1814.
Aujourd’hui premier mars mil huit cent quatorze est comparu le sieur Mathurin de Moy, commandant du chasse-marée Eulalie, de l’Aberildut, du port de dix tonneaux 68 / 94e , déclare venir de Brest et être chargé suivant deux acquit à caution et un passavant à destination de Pontusval, portant . le premier acquit n° 1er en date du 11 février 1814, dix mille kilogrammes de sel, allant par suite d’un trépas, . le deuxième acquit à caution n° 33 en date du onze février 1814 portant seize barriques de vin contenant trente six hectolitres quarante huit litres, tous deux signés Saint Géran . le passe avant n° 135 portant deux barriques de vin en date du 11 février 1814, signé Guereaux.
Le dit Mathurin de Moy déclare qu’il est parti de Brest le douze février 1814, les vents au Nord dé ; le même jour, ils ont relâché à Berthom avec le capitaine Marzin qui alors commande ledit bâtiment.
Le treize, ils ont appareillé à six heures du matin pour faire route pour l’Aberildut où ils font entrée dans la rade dudit lieu à neuf heures du soir, où ils sont restés jusqu’au dix huit dudit mois, dont ils sont partis à six heures du matin, les vents au Nord dé pour faire route pour Portsal où ils sont arrivés à quatre heures du soir le vingt dudit mois, le capitaine Marzin ayant voulu porter secours à un bateau pescheur s’étant embarqué dans son canot qui a chaviré, ledit capitaine Marzin a le malheur de se noyer dans la rade de Portsal sur les dix heures du matin, ledit chassse-marée a resté dans cette rade jusqu’au vingt sept dudit mois.
Le vingt huit, les vens de la partie du nord norois, avons fait route pour Guissény, sur les huit heures du matin, où nous avons mouillés sur la rade dudit Guissény environ les trois heurs après midy, où étant le navire ayant ses ancres dehors, le bâtiment à frapé à plusieurs reprises et à soufert, dont nous n’avons put quitter la pompe, nous avons sur les onze heures du soir dû fair lever les encres. La mer étant très agitée nous a jeté dans le port avec force, où le bâtiment à touché sur une roche où le navire à coulé à fond, où moy capitaine et mon mousse n’ont eu que le temps de nous sauver dans notre canote ; pour cette accident, le sel se trouve coulé, le navire étant maintenant au fond de la mer.
Ce que de tous cy dessus et de l’autre part, je déclare sincère et véritable ainsi que mon mousse nommé Michel Guioc qui déclare ne savoir signer, le capitaine a signé.
Mathurin demoy
Le naufrage du « Bon Succès »
Le naufrage du « Bon Succès » en 1788
En janvier 1788, le navire danois « Bon Succès » chargé de toiles vint à la côte à Guissény. Les riverains vendirent les toiles naufragées. Quatre des acheteurs, les épiciers C. Rollet et Jérôme Le Bon, le fripier J. Devaux et le chapelier J. Bernicot furent incarcérés au château de Brest.

- Chateau de Brest
Bernicot put s’évader. Les autres furent élargis provisoirement en août 1789. La municipalité de Brest pria les députés Legendre et Moyot de supplier la clémence du Roi en leur faveur. Le 18 février 1790, Lunven de Coatiogan, (avocat à Brest) fut chargé de demander des lettres d’abolition « pour les anciens détenus ». Bernicot, enfui de Brest, craignait fort de n’y pouvoir rentrer.
Le navire avait déjà eu des problèmes en 1765, mais pour de la contrebande cette fois-là !
La Gazette de France, du lundi 5 août 1765 :
« Le sieur du Chaffaut, chef d’escadre, commandant le vaisseau l’Utile, joignit le 11 juin 1765, un navire danois, nommé le Bon Succès, de deux cents vingt tonneaux, expédié de Constantinople au commencement de mai avec un chargement de dix canons de bronze, cinq cents quintaux de poudre à feu, quinze boulets, trois cents cinquante rames et plusieurs mâts que le Capitaine avoua qu’il portoit à Salé. La destination de ces munitions de guerre étant pour les Ports bloqués de nos ennemis, ce Navire est évidemment dans le cas de la confiscation aussi bien que son chargement. En conséquence, il a été envoyé au premier Port de France sous l’escorte de la Frégate La Biche ». « On vient d’apprendre que le Navire danois le Bon Succès, qui alloit à Salé, chargé de munitions de guerre et que le sieur du Chaffaut a arrêté, est entré dernièrement à la rade de Brest avec la Frégate La Biche qui l’escortoit ».
Les Paganiz, des naufrageurs ?
Les Paganiz, des naufrageurs ?

- Le naufrageur, la vache et la lanterne
« Les habitants de ces rivages semés d’écueils sont remarquables par leur haute stature et le caractère de férocité généralement empreint sur leur physionomie. Ils sont ceux du département qui ont conservé avec le plus de ténacité l’usage barbare de piller les bâtiments naufragés et d’en dépouiller, d’en maltraiter les malheureux équipages avec une cruauté de vrais sauvages. Ils apportent à cette action une fureur, un acharnement inconcevable…Peignez-vous la position de ces hommes et de ces furies qui, la nuit, l’hyver surtout au moment des orages, cachés dans les enfoncements du rivage, l’œil tendu vers les flots, attendent les dons de la mer… Dans les temps reculés, ils allumaient des feux, ils pendaient un fanal à la tête d’une vache pour attirer les vaisseaux éloignés, trompés par le mouvement de ces animaux et par ces feux qu’ils croyaient pouvoir suivre ».
« Ceux qui allumeront la nuit des feux trompeurs sur les Grèves de la Mer et dans les lieux périlleux, pour y attirer et faire perdre les Navires, seront aussi punis de mort, et leurs corps attachez à un Mast planté aux lieux où ils auront fait les feux ».
« Il y a pis que les écueils, pis que la tempête. La nature est atroce, l’homme est atroce et ils semblent s’entendre. Dès que la mer leur jette un pauvre vaisseau, ils courent à la côte, hommes, femmes et enfants, ils tombent sur cette curée. N’espérez pas arrêter ces loups, ils pilleraient tranquillement sous le feu de la gendarmerie. Encore, s’ils attendaient toujours le naufrage, mais on assure qu’ils l’ont souvent préparé. Souvent, dit-on, une vache promenant à ses cornes un fanal mouvant, a mené les vaisseaux sur les écueils. Dieu sait alors quelles scènes de nuit ! On en a vu qui, pour arracher une bague au doigt d’une femme qui se noyait, lui coupaient le doit avec les dents. L’homme est dur sur cette côte. Fils maudit de la création, vrai Caïn, pourquoi pardonnerait-il à Abel, La nature ne lui pardonne pas… ».

- La vache et son fanal en mouvement
La description de Michelet ne s’appuie que sur des « on assure » ou des « dit-on » mais l’évocation de scènes atroces suscite suffisamment l’imaginaire romantique pour donner consistance à un mythe qui se développe tout au long du XIXè siècle dans la littérature française1. Pourtant le dépouillement des archives maritimes ne fait pas apparaître les feux comme origine des naufrages : l’inventaire de l’amirauté de Léon ne contient aucune condamnation liée à ce type de méfait.
« Tout le monde connaît, au moins de nom, dans le Finistère, ce coin de terre païen - lan ar pagan - qui se conserva païen, en effet, jusqu’en plein XVIIè siècle. C’est là que résidait, sans se mêler à ce qui l’entourait, une indomptable race, vivant de l’océan comme d’un domaine naturel, et regardant comme gain légitime tout ce que lui apportait l’océan. Souvent même, quand l’océan se montrait trop lent à produire, on l’y forçait, comme on fait d’un rebelle. Malheur aux voyageurs que leur destinée menait en vue de la terre des païens dans l’obscurité d’une nuit d’hiver ! Mieux eût valu l’approche du plus impitoyable récif que celle de ce rivage inhospitalier. Devant eux apparaissait une lumière qui, sans cesse, changeant de place, semblait suivre les oscillations d’un navire en marche. Les voyageurs approchaient sans méfiance du navire imaginaire jusqu’à ce que le choc inévitable les avertit de leur erreur, et qu’ils pussent voir - trop tard, hélas ! - accourir des replis de falaise, le croc à la main, les païens qui avaient apprêté l’embûche et qui venaient en recueillir le fruit. On pense bien que ces instincts de sauvages se sont fort modifiés ; mais on peut penser qu’ils ne se sont pas effacés d’un seul coup. Il n’y a plus de païens ni de naufrageurs, mais il y a encore des maraudeurs de mer qui ne se sont pas déshabitués de regarder tout ce qui flotte sur l’océan comme propriété collective. En voici un frappant exemple… Il s’agit du pillage d’une carcasse de navire échouée sur la côte de Guissény.

- Guetteur
A peine la masse flottante eût-elle été signalée par un cri guttural qui n’a d’équivalent nulle part, même dans le monde des rapaces nocturnes, que de tous côtés accouraient les riverains armés de crocs et de faux. Un instant après, l’épave était amenée à terre, et attaquée dans tous les sens par de robustes bras. Comme la démolition n’allait point assez vite, les instruments de travail furent remplacés par d’énormes galets et le jeu recommença de plus belle. Sous les coups multiples de ces marteaux essentiellement primitifs, les pièces de bois cédèrent à l’envie, et ne tardèrent pas à se disjoindre. Alors, des charrettes que le hasard n’avait point amené là, mais nos païens, hommes de précaution, furent chargées sans perte de temps et quand les agents de la Marine Nationale arrivèrent, entre 10 et 11 heures, pour reconnaître l’épave qu’un œil vigilant avait aperçue de loin… mais de très loin, la grande grève était déserte et le tour était joué ».
"Sans doute leurs ancêtres avaient-ils provoqué des naufrages lorsque la Providence ne les suscitait pas elle-même ; mais s’ils demeuraient encore, et si leurs descendants demeureront longtemps après eux, experts accomplis dans l’art de réduire une épave à la plus sommaire des carcasses, ils n’étaient tout de même plus, au début du XIXe siècle, ce que la couleur locale allait bientôt exiger qu’ils demeurent (le thème, très romantique, du naufrageur était déjà couramment traité sous Louis-Philippe)".
Et aujourd’hui, dans le cadre du tourisme de la Côte des Légendes, on organise même un trail des naufrageurs !!

- Trail des Naufrageurs
Sources :
- Alain CABANTOUS, « Les côtes barbares - pilleurs d’épaves et sociétés littorales en France - 1680-1830 », Fayard, 1993.
- Jean-Pierre HIRRIEN, « Naufrages et pillages en Léon », SkolVreizh, Morlaix, n° 46, mai 2000.
- Yvon GAC, "Guissény, histoire d’une commune au cœur du pays pagan".
Les Paganiz, des pilleurs d’épaves

- Pilleurs d’epaves
Le droit de bris (ou droit de lagan, ou perçois de mer, ou le peñse) appartient aux Ducs de Bretagne au Moyen Age comme droit régalien, mais leurs vassaux du littoral en usaient par concession ou par usurpation. Il en fut ainsi du Vicomte de Léon : en vertu du droit seigneurial, toutes cargaisons de marchandises jetées sur le littoral lesnevien (des grèves de Tréflez à celles de Plouguerneau) devenaient propriétés exclusives du châtelain de Lesneven. Ce droit était particulièrement cher au seigneur du lieu, si l’on s’en rapporte aux déclarations d’un certain Hervé, vicomte du Léon qui, du doigt, désignant un groupe de rochers du littoral - Kerlouan, vraisemblablement - s’écria : « Voilà une pierre noire que je n’échangerais pas pour les diamants de toutes les couronnes du monde ».
Au milieu du XVè siècle, le châtelain renonça momentanément au droit d’épaves au profit d’un gentilhomme qui, en compensation, devait fournir les cordages nécessaires à la pendaison des criminels déférés à la cour de Lesneven. En 1457, ces fonctions étaient dévolues à l’un des trois choristes du Folgoët, « un petit Pilguen de Plouider, du doux manoir de Kérouriou. Il avait la maîtrise sur toutes les grèves du littoral lesnevien, ce qui lui faisait dire : flux ou reflux, je suis partout le maître et Kérouriou est mon nom ».
. Ce rocher, cause continuelle de naufrages, était situé, selon certains auteurs, sur le littoral de Kerlouan (Marius-Fernand et Louis BLANC, « Histoire anecdotique de Lesneven, du Folgoët et des alentours », Brest, 1927). Mais Cambry le fixe à la pointe du Raz, territoire relevant également à l’époque du Comté de Léon.
L’Eglise tenta de lutter contre ce droit de bris : ainsi, lors d’un synode tenu à Nantes en octobre 1127, elle condamna cet usage et menaça d’excommunication ceux qui n’y renonceraient pas. Mais l’habitude était tellement ancrée dans les mœurs que les interdictions maintes fois renouvelées n’y changèrent rien. Les conflits continuèrent entre les ducs et les vicomtes de Léon pour la possession de ce droit et se poursuivirent encore avec le pouvoir royal après le rattachement de la Bretagne à la France.
L’édit de 1691 organisa les amirautés : celle de Léon avait son siège à Brest. Le personnel n’était pas nombreux et souvent éloigné des lieux de naufrages ; les juges déléguèrent leurs pouvoirs à des représentants pour assurer une meilleure surveillance des côtes : des commis et des garde-côtes. C’était le cas à Guissény où l’on peut toujours voir la maison des gardes (« le corps de garde ») . Toutes les autorités locales (curés, seigneurs, syndics) avaient obligation de prévenir l’amirauté, de s’occuper du sauvetage et d’empêcher les pillages avant l’arrivée des officiers. Pendant la révolution, cette mission fut confiée aux juges de paix des cantons et aux douaniers.

- Le Corps de Garde
Les habitants de ces littoraux qui menaient une vie difficile et avaient l’habitude de se battre avec les éléments marins pour récolter le goémon, voyaient arriver les débris des naufrages comme une bénédiction. « Cette culture littorale se fonde sur un raisonnement simple : tout ce que la mer apporte aux découvreurs s’apparente à une cueillette naturelle pour des individus qui ne possèdent pas grand chose [Jean Pierre Hirrien] ». Lorsqu’un naufrage était connu, la population arrivait de toutes les paroisses voisines : lors du naufrage du Bon Succès (le 25 décembre 1787), on observe la présence de représentants de six paroisses (Kerlouan, Guissény, Plouguerneau, Lannilis, Ploudaniel et Lesneven) et « des charrettes aussitôt attelées ont transporté dans plus de trente paroisses le fruit de leurs rapines ».
Entre 1681 et 1815, J.-P. Hirrien compte 6 naufrages à Guissény et 18 à Kerlouan, dont 6 ont donné lieu à des pillages. Toutes les communautés littorales participaient plus ou moins au pillage mais tous leurs membres ne se comportaient pas de la même façon : Cambry notait « qu’il existe pourtant des familles qui ne participent jamais à ces vols ; qui se croiraient déshonorées si, quand la multitude court au rivage et va se partager la dépouille des naufragés, elles faisaient un pas pour y participer ». L’intérêt des pilleurs se concentrait sur trois marchandises principales : le bois, les vêtements et l’alcool. Les violences envers les équipages sont en général limitées : les pillards portent secours aux rescapés, du moins lorsque ceux-ci ne cherchent pas à s’opposer au pillage.
Les frères Blanc, dans leur livre sur l’histoire de la région, rapportent un certain nombre d’anecdotes relatives au pillage des épaves du côté de Guissény et de Kerlouan. Ils relatent, par exemple, le fait qu’à leur époque (début du XXè siècle), il est rare de trouver le moindre bijou sur les cadavres déclarés par les Paganis : « Or, les marins ont toujours des montres sur eux, dit un brigadier des douanes, et j’ai souvent relevé au doigt des cadavres déclarés le rond pâle que laisse une bague et les écorchures encore fraîches qui prouvent que l’anneau avait été arraché violemment ».
Les épaves que la tempête et les courants entraînent vers le littoral, et plus spécialement les « spiritueux en fûts », auxquels ces populations semblent accorder une préférence marquée, sont toujours considérés comme « un don du ciel ». Ainsi, en 1903, lors du naufrage du Wesper, dans les parages d’Ouessant, quantité de fûts et de barils de vin, emportés par le courant, vinrent, pour la plus grande joie des riverains, s’échouer parmi les nombreux rochers des grèves de Kerlouan. Avec une adresse et une dextérité surprenantes, les Paganis recueillirent quantité de fûts, prestement dissimulés à l’œil inquisitorial « des gabelous » (douaniers).

- Pilleurs d’epaves (Auguste Lepère)
Alors, durant de longs mois, ce fut une beuverie interminable : hommes, femmes et enfants purent, sans bourse déliée, se livrer à de copieuses libations. Or, il advint que, dans une ferme isolée du littoral, la maisonnée tout entière demeura plusieurs jours sous l’empire de l’ivresse, sans souci aucun des quelques têtes de bétail enfermées dans l’étable. Même, les lugubres beuglements de ces pauvres bêtes ne purent faire sortir de leur torpeur les gens de la ferme. La presque totalité de ce bétail succomba d’inanition.
Un autre fait, ayant trait au même naufrage, témoigne de l’astuce, du cynisme de certains pilleurs d’épaves : une honorable et vieille commerçante de Guissény, ignorant tout d’ailleurs des lois réglementant la vente des épaves, se laissa fléchir par les instances aussi obsédantes qu’intéressées d’un de ces endurcis pirates de Garrec-Hir, en Kerlouan, et lui acheta un superbe fût de vin d’épave. La livraison, contre remboursement, s’effectua par une nuit profonde et obscure. L’astucieux livreur poussa la complaisance jusqu’à dissimuler entièrement le tonneau sous des fagots entassés dans la cour de l’habitation, avec recommandation expresse de ne point mettre la futaille en perce avant une vingtaine de jours, afin que le dépôt du liquide pût s’opérer dans de bonnes conditions. Cette recommandation n’était ni superflue ni surtout désintéressée : le délai expiré, notre brave et trop confiante aubergiste s’apprêtait enfin à procéder à la mise en bouteilles du précieux liquide lorsqu’elle s’aperçut de la disparition mystérieuse du fût ! Elle apprit dans la suite que le cynique pirate, non content d’avoir empoché l’argent, avait mis à profit une nuit noire pour procéder à l’enlèvement du vin avant la date qu’il avait lui-même si obligeamment fixée pour la mise en bouteilles. Que faire en l’occurrence ? Déposer une plainte ? Il n’y fallait point songer, sous peine d’encourir les foudres du fisc. Mieux renseignée, notre infortunée aubergiste jura - mais un peu tard - qu’on ne l’y reprendrait plus !
A propos de ce même naufrage, un entrepreneur de la région lesnevienne, en relations constantes avec les Paganis, raconta aux frères Blanc les faits suivants, vraiment typiques, dénotant de la part de leurs auteurs une mentalité peu ordinaire :
Dès qu’on apercevait un fût flottant sur les eaux, on allait à sa rencontre à la nage. On le déposait verticalement sur le sable ; on en faisait sauter la partie supérieure ; puis, au moyen de sabots d’une propreté plus que douteuse, chacun s’abreuvait à qui mieux mieux. Le niveau du liquide s’abaissait-il ? L’un des sauveteurs, en tenue de bain, sautait dans le tonneau et remplissait tous les récipients qu’on lui présentait.
Plus loin, deux paysans roulaient discrètement deux énormes fûts de vin. On les aperçoit. Ils se voient aussitôt entourés d’une meute hurlante, réclamant une part du précieux butin. Le vacarme est tel que les douaniers, accourus, ordonnent jusqu’à plus ample informé, la remise des fûts dans une grange voisine, au seuil de laquelle ils montent la garde jusqu’à la nuit tombante. Sitôt partis, la grange est assaillie, la porte démolie, les fûts défoncés, puis une bataille générale s’engage à coups de seaux pour la possession du vin.

- Pilleurs d’epaves
Dans les mêmes parages, un vieux paysan des plus madrés avait réussi à recueillir 12 tonneaux de vin. Heureux de son aubaine, il remisa le tout dans sa grange. Pour plus de sûreté, il fit murer l’ouverture de la remise. Précaution illusoire pour qui connaît les ruses des pilleurs d’épaves. Peu de jours après, en effet, trois tonneaux sont enlevés : la toiture en chaume avait été défoncée et les trois épaves, à l’aide de forts cordages, avaient disparu par cet orifice d’un nouveau genre. Outré d’un pareil sans-gêne, notre rusé paysan s’arma d’un fusil et la nuit demeura en faction au seuil de sa remise. Mais ses compatriotes sont gens à ne point se laisser intimider. A leur tour, ils s’armèrent de fusils de chasse et la poudre entra en jeu. Ce fut miracle si personne ne perdit la vie. Tous ces coups de feu avaient attiré l’attention des douaniers qui mirent fin à ces combats en pratiquant l’enlèvement des fûts restants, objets du litige, et en gratifiant nos bons bougres de quelques procès-verbaux pour détention et enlèvement illicites d’épaves. N’est-ce pas au cours d’une de ces orgies « qu’une vieille femme fut retirée d’un fût où elle se penchait trop amoureusement » et qu’une autre hallucinée s’écriait : « O Dieu puissant qui changes la mer en vin » ?
Lors du naufrage de l’Amboto, chargé de houille, et survenu le 14 juillet 1908, plusieurs habitants de Garrec-Hir - principal quartier, avec Kérisoc, des pilleurs d’épaves - montèrent à bord du navire pour enlever tout objets à leur convenance : glaces, cuivre, etc… Les chaînes mêmes ne furent pas épargnées ; on les enleva à coups de masse et tout cela en présence de l’équipage, littéralement ahuri par un tel cynisme. Si certains pilleurs d’épaves impénitents font des dupes, des victimes, d’autres par contre, paient, parfois de leur vie, leur amour immodéré de certaines épaves, témoin le fait suivant : « Le 19 août 1917, de nombreux cultivateurs coopéraient aux travaux agricoles, à la ferme Habasque en Kerlouan. Après le battage de la récolte, il fut offert aux travailleurs quelques petits verres d’alcool. Or, dès le lendemain, l’un des buveurs, Jean Coat, domicilié à Ploudaniel, était fortement indisposé, se plaignait surtout de douleurs à la tête. Un docteur fut mandé qui ordonna le transfert du malade à son domicile. Mais ce dernier ne put supporter le voyage et mourut en cours de route. Le même jour, Tanguy Le Bihan, qui avait également travaillé la veille chez son voisin Habasque, mourait dans les mêmes conditions à son domicile. Deux autres cultivateurs, Jean Jaffrès et Ollivier Bihan furent fortement indisposés. La justice fut mise au courant de ces faits, et l’on apprit que Habasque avait découvert peu de temps auparavant, sur la grève, un fût d’alcool, qu’il crut être du trois-six. Sa fille avait alors mélangé ce liquide, qui n’était autre que de l’esprit-de-bois, avec de l’eau-de-vie ordinaire. C’est ce breuvage qui avait été donné aux travailleurs et qui occasionna leur mort. François Habasque et Marie Jeanne Habasque furent condamnés à deux mois de prison avec sursis » [Extrait du journal « La Dépêche de Brest et de l’Ouest », 9 février 1918].
Au cours de l’année 1918, plusieurs navires sont encore torpillés dans les parages de Kerlouan. L’un était chargé de grandes feuilles de caoutchouc vulcanisé, sorties d’une grande firme américaine. Les riverains de Garrec-Hir, notamment, en font une ample récolte dont ils escomptent déjà le produit de la vente. Mais les douaniers sont là, l’œil aux aguets et l’oreille aux écoutes. Impossibilité absolue d’écouler immédiatement les précieuses épaves. Alors nos bons pirates, en vue de remédier sans doute à la pénurie du bois dans la région, imaginent d’utiliser les feuilles de caoutchouc comme combustible ! Les vapeurs âcres et sulfureuses qui s’en dégagent leur chatouillent fort désagréablement les narines et les obligent à renoncer, dès le premier essai, à ce genre de combustion peu ordinaire. Des personnes peu scrupuleuses, mais plus avisées, en quête d’une bonne aubaine, parviennent après paiement et après avoir trompé la vigilance des douaniers, à se procurer plusieurs feuilles de ces épaves, vite découpées en pièces et sitôt débitées pour servir de semelles aux chaussons et aux espadrilles ! Ce nouveau genre de semelles remporta, à Guissény, un succès incroyable, surtout près des femmes et des enfants. Tous en portaient au vu et au su des douaniers. « Que voulez-vous, disait M. H…, l’actif brigadier des douanes, nous ne pouvons cependant pas verbaliser contre toute la population ? Nous avons déjà fait rendre gorge à quelques-uns des pilleurs d’épaves disposés à en faire livraison à des industriels - mercantis, peut-être, - de Brest, de Landivisiau et… d’ailleurs. Un moment, nous avons cru mettre la main sur l’un de ces gros receleurs : son auto stationnait à la porte d’une ferme tenue par nous à l’œil. Éventé, le coup a manqué. Espérons que ce n’est que partie remise ; bientôt, peut-être, aurons-nous notre revanche… ». Par la suite, l’active brigade de Guissény réussit à récupérer plus de 7.000 kilos de feuilles de caoutchouc !.
La tradition du pillage était profondément ancrée dans la mentalité des populations du pays pagan comme en témoignent ces dictons et cette profession de foi prêtée aux gens de Guissény, selon Michel de Mauny :
Lec’h ma dremen ar Pagan | Partout où passe le Pagan Atao e daol e graban | Toujours il lance sa main crochue
Paotret Guisseni | Gars de Guissény Paotret ar c’hill krok | Joueurs de perche à crochet (pour tirer au sec les épaves)
La profession de foi dit ceci :
Avel uhel, avel Nord | Le vent haut, le vent du Nord A zigas ar pense d’ar bord | Amène les épaves à la côte Ha me araok | Et moi d’y courir Da c’hoari va Paotr | Pour y faire mon beau diable Ha pad-agenn d’ar grouk | Et que j’irais à la potence Tenio eun tortad war | J’emporterai mon faix (de butin) Va chouk | Sur mes épaules
L’ancienne auberge du bourg de Guissény était le témoignage vivant de cette tradition de pilleurs d’épaves (Charles Le Goffic, "Sur la côte") :
« Une des auberges les plus curieuses que j’aie visitées, est à Guissény. C’est la principale de l’endroit et elle fait hôtel pour les voyageurs de commerce et les rares baigneurs qui s’y rendent aux beaux mois. Le patron de l’auberge est en même temps ébéniste et marchand de curiosités. L’auberge est propre et sans grande apparence extérieure. Mais, à peine entré, on est frappé par la singularité de l’ameublement : la table de la salle à manger est une table longue, en acajou massif, comme les tables des paquebots ; la suspension, les serrures, les poignées des portes, les patères sont en cuivre, comme à bord. Pour descendre dans la cour, vous suivez une rampe de passerelle ; dans cette cour même, vous apercevrez d’énormes ancres, des organeaux, des ventilateurs, des mâts de charge. Trois ou quatre de ces mâts, encore cerclés de fer, supportent la toiture d’un hangar ; dans ce hangar, pêle-mêle, avec de vieux bahuts, des crédences et des lits bretons, voici des planches de pitchpin, des billes d’acajou verdies par la mer. D’où vient tout cela ? du Penzé. Chacun de ces objets a sa date, se rapporte à un naufrage lointain ou récent. Et vous ne voyez encore que ce qui peut être montré ou que couvre la prescription. Le cas de ce patron d’auberge est-il unique ? Point. On me cite un tel, ancien meunier retiré des affaires, ayant grande habitation bourgeoise, cour, arrière-cour, jardin fruitier, potager et d’agrément, et dont tout le mobilier, jusqu’aux ustensiles de ménage, trahit la même origine. Evidemment ni cet ancien meunier ni cet aubergiste ne sont des pilleurs d’épaves… ».
La mer continue à apporter des matières diverses sur les plages du pays pagan. Lorsqu’il y a un arrivage intéressant le vieil atavisme se réveille très vite, le bouche-à-oreille fonctionne très bien (surtout maintenant avec les smartphone et les réseaux).La plage est très vite nettoyée des planches de bois, des paquets de tabac,… Mais lorsque la mer apportait ses nappes de pétrole, les Paganiz savaient aussi serrer les coudes pour se débarrasser au plus vite de cette pollution.
Voyage chez les Paganiz en 1928
(La Dépêche de Brest et de l’Ouest, lundi 12 novembre 1928, p. 1)
Où nous faudra-t-il courir, dans huit ou dix ans, pour découvrir quelque trace de la Bretagne légendaire, emmurée dans ses traditions, qu’on évoquée Brizeux, Souvestre et, plus près de nous, Anatole Le Braz ? Voilà ce que je me disais, en visitant, par ce dernier mois d’août, cette région du Léon, - de Brignogan et de Guissény, - qui semblerait devoir être le suprême réduit de la vieille Bretagne sauvage, région des Paganiz qui, à en croire les légendes, porteraient dans leurs veines du sang de païens et de bagnards.
Je le croyais d’autant mieux que je venais de relire "Sur la côte« , le beau livre de Charles Le Goffic, et, des frères Blanc, la si attachante »Histoire anecdotique de Lesneven", où il est question des naufrageurs, des « Paotred-ar-c’hilkrog » de Kérisoc et de Garrek-Hir, qui se saoulent de vin d’épave et arrachent les bagues, coups de dents, des doigts morts des naufragés. Mon bon ami Tanguy Millour, à vrai dire, m’avait fait entendre un autre son de cloche, en me représentant ce pays de Brignogan, qui lui est familier, comme un pays ni plus ni moins sauvage que n’importe quel autre du Finistère. Mais j’apportais à le croire assez de mauvaise volonté. J’ai vu depuis lors qu’il avait raison.

- Femmes de Brignogan
C’est toute une expédition que de se rendre de Brest au pays des Paganiz, par le petit train qui n’a d’économique que le nom et qui parcourt bien huit kilomètres à l’heure. Et le Léon qu’on traverse, entre Gouesnou et Plabennec est, en effet, assez triste : un immense tapis vert, parsemé de landes, que des rigoles d’irrigation découpent en milliers de cases inégales, et où des vaches, lourdes d’herbe, regardent passer des trains. Des clochers à jour y poussent au lieu d’arbres, tendant leurs antennes grises vers le dôme bas du ciel. Le pays sent l’encens et le lait, le bœuf Durham et le cierge pascal.
Tristes aussi sont les voyageurs : des Léonardes à petite coiffe et à petit châle noir, plongées en apparence, même en faisant leurs comptes, dans une perpétuelle oraison, et qui font songer aux paysannes des vitraux gothiques, telles qu’on les voit dans les images des Histoires de France ; tandis que les Léonards, sous leur chapeau à balancine et leur habit à courtes basques, ressemblent à des figurants d’opéra, glabres et dignes.
A Plouider, le paysage change. Le ciel s’ouvre, de Plouguerneau à Tréflez et à Plounévez-Lochrist, et c’est l’un des horizons les plus lumineux, des plus étendus de la Bretagne. Le train fait feu de toutes ses roues et s’époumone à dégringoler la rampe.

- Gare de Plouider
La baie de Goulven, où fut terrassé le dragon, offre au steeple des vagues, à marée montante, un beau terrain de sports matelassé de dunes. Plounéour-Trez, riche de son beau nom – Plounéour des Sables – est riche aussi des belles verdures qui l’environnent.

- Gare de Brignogan : arrivée des voyageurs
Et puis voici Brignogan, qui est, en effet, une station charmante, tenant le milieu entre Carantec et Ploumanach – et comme il y en a chez nous par douzaines. – Des rochers, des criques de sable blanc, des villas de tous les styles, de tous les formats, de toutes les couleurs : des grises, des bleues, des roses, des blanches. Des villas de Goélands et des Mouettes, des Ker-Aline et des Ker-Yvonne, des Ker-Azur et des Ker-ar-Mor. Des écriteaux aux lettres blanches, consciencieusement peintes, indiquent,, à la croisée des routes, les directions du Phare et du Menhir. Des garçonnes, en fumant des cigarettes, finissent de s’ocrer les jambes au soleil, à côté de misses anguleuse, - made in England, - qui font, après leur bain de la gymnastique suédoise.
Des hôtels, - du Léon, des Bains, de la Mer, - des courts, des garages, des pompes à essence et des maisons de thé, anciennement couvertes de chaume, pour les Parisiens de Landerneau, avec five o’clock à toutes les heures.

- Brignogan : le Grandhôtel
Mais de naufrageurs, à Brignogan, on n’en saurait trouver plus trace qu’à Beg-Meil ou à Saint-Pierre-Quilbignon. Alors quelque peu dépité, nous les avons recherchés ailleurs et avons fait bravement la route, jusqu’à leurs repaires présumés de Kerlouan et de Garrek-Hir. Là encore, rien que de parfaitement civilisé et pacifique.

- Pêcheur de Brignogan ou Kerlouan
La vieille route de l’Aberwrac’h, la route des Occismor et des Tolentes englouties, où l’on rançonnait jadis les voyageurs, s’en va d’un trait, escaladant la colline, sillonnée de camions-autos qui mêlent un relent d’essence à l’odeur salubre des ajoncs. De chaque côté, des maisons sans fenêtre de guet tournée vers le Penzé et de beaux troupeaux qui paissent. Au lieu du Sao, ou du Kousk Breiz-Izel, ou du Bro goz ma Zadou, une bergère chante, sans paraître autrement y compatir, les tribulations d’une pauvre fille de Bédouins qui, pendant soixante ans, « suivit nuit et jour une caravane ».
De robustes Kerlouanaises à bicyclette, les poings crispés sur le guidon, les petites cornes de leur coiffe de pen-maout au vent, piquent des emballages en descendant les côtes et baissent la tête comme des coureurs. A l’entrée du village, devant une belle maison de maître, des marmots aux pieds nus, aux mollets roux, qui paraissent bien appartenir à quelque colonie de vacances, parlent français avec l’accent de Montmartre ou de Ménilmontant.

- Brignogan, Plounéour, Guissény
Le bourg de Kerlouan lui-même avec son unique rue bordée de maisons blanches et son presbytère auquel conduit une allée de hêtres, ne se distingue guère de tous les petits bourgs que l’on peut voir au long des routes de Léon et de Cornouaille. Une église neuve, spacieuse et banale, écrase de sa masse l’église ancienne, désormais abandonnée, aux dalles disjointes, culottée de lichens et de mousses, dépouillée de ses vitraux, - un vrai sanctuaire, sentant l’humidité marine, de boucaniers et de pilleurs d’épaves.
Des vieux saints locaux, comme Egarec et Goulven, taillés dans du bois d’œuvre de Saint-Vougay et qui ont de bonnes faces d’évêques de Saint-Pol, sont relégués dans l’ombre des bas-côtés, en proie aux brumes et aux vers, navrés, dirait-on, de leur disgrâce, pour faire place à des bondieuseries de saint Sulpice, des saint Michel et des sainte Jeanne d’Arc à l’étendard, sans caractère et sans solidité.
Avant de revenir sur nos pas, de plus en plus déçus dans notre amour de pittoresque et de couleur locale, nous nous sommes rafraîchis, en une petite auberge qui fait face à l’église et dont l’hôtesse, trottinante et menue, nous a paru tout à fait affable. Et comme nous lui exprimions notre surprise de ne trouver à Kerlouan nulle trace de ces naufrageurs au bonnet à oreillettes, qui, jusqu’à présent, en firent la gloire :
- Comment dites-vous, mon bon monsieur ? Des naufrageurs ?…
Je la regardai, stupéfait de ce qu’elle ne me comprît point davantage. Et, enfin, se ravisant, elle finit par nous dire, sur un ton de confidence :
- Des naufrageurs ?… Au fait, je crois saisir. Ça doit être un mauvais fruit que les gens de Plounéour-Trez, des jaloux et des effrontés, ont fait courir sur notre compte, pour nous être désagréables.
François MENEZ